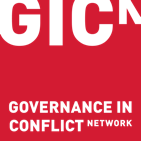Quand la guerre menace la recherche : la force des liens humains dans la collaboration scientifique

Ce blog explore comment, en contexte de guerre, des gestes simples de soutien entre chercheurs peuvent maintenir l'intégrité scientifique et préserver la collaboration Nord-Sud. Loin d’être anecdotiques, ces actes ordinaires deviennent essentiels pour affirmer une présence, une reconnaissance mutuelle et une continuité intellectuelle. À partir d’un témoignage vécu, le texte propose une éthique relationnelle de la science, fondée sur la constance du lien humain. Il invite à repenser la valeur des partenariats scientifiques, notamment dans les situations de vulnérabilité et de crise.
Faire la science ensemble en période de crise suscite un intérêt croissant dans la recherche. De Sousa Santos (2016) met en évidence que les crises exposent les faiblesses des savoirs prédominants. Latour(2005) démontre que la science repose sur des réseaux sociétaux et matériels. Star et Ruhleder (1996) insistent sur la pertinence des appuis implicites dans l'activité scientifique. Fricker (2007) et Medina (2013) développent le concept de coopération épistémique face à la marginalisation. Conjointement, ils rappellent que l'exercice de la science implique également le maintien de la cohésion en temps de crise.
Au début de la guerre à Bukavu (Sud-Kivu, RDC) en février 2025, mes impératifs ont subi une réorientation radicale. La survie a prévalu sur la production intellectuelle. Néanmoins, au sein de cette désorganisation, des actions élémentaires ont contribué à préserver mon identité de chercheur : une communication écrite, un message oral, une intonation connue. Ces manifestations, bien qu'épisodiques ou imparfaites, ont eu une influence significative. Elles ont réaffirmé mon appartenance à une collectivité, ma légitimité à être entendu. Fréquemment considérés comme accessoires, ces témoignages d'égard constituent en réalité des actes épistémiques, ils autorisent la persistance d'une réflexion, même dans des circonstances précaires. Cette situation m'a contraint à une réévaluation de la perspective, la science ne se limite pas aux procédures et aux conclusions. Elle se manifeste également à travers la valeur du lien humain qui soutient la pensée.
Dans les partenariats scientifiques Nord-Sud, les discours valorisent souvent la collaboration, la co-construction et l’égalité. Pourtant, dans la réalité quotidienne, des disparités profondes demeurent. Lorsqu’une crise survient, ces inégalités deviennent flagrantes : le chercheur du Sud se trouve parfois contraint à l’exil ou à la survie dans des conditions extrêmes, tandis que son homologue du Nord continue sa vie, souvent démuni face à cette rupture soudaine. Un témoignage courant au Nord reflète un sentiment d’impuissance et de fatalisme.
Cependant, mon expérience personnelle montre une autre vérité. Des gestes simples ; un message, un appel, un message, une attention n’ont pas apporté d’aide matérielle, mais ont préservé une intégrité symbolique essentielle. Ces signes ont réaffirmé mon statut de chercheur, au-delà d’une simple présence physique menacée. Ils ont aussi permis à mes collègues du Nord de dépasser une posture passive : sans pouvoir résoudre tous les problèmes, ils ont affirmé une présence significative. S’engager comme collaborateur en temps de crise ne signifie pas avoir une solution, mais maintenir un lien, même face à la peur de mal faire. C’est dire à l’autre : « Je suis là. Je t’écoute. Ta contribution reste essentielle. »
Cette réalité, je l’ai vécue de l’intérieur lors de l’émergence de la crise sécuritaire en Est-RDC début 2025. J’étais encore chercheur, mais devenu une cible. Mon quartier est proche d’un camp militaire. Les affrontements étaient incessants : les balles crépitaient jour et nuit. Des obus tombaient à quelques mètres. Une grenade est même tombée dans ma parcelle, détruisant tout sur son passage. Ce jour-là, abrité dans le couloir, piégé dans ma propre maison, j’ai cru que tout était fini pour moi et ma carrière de chercheur. Pourtant, ce qui m’a maintenu debout, ce sont les appels et messages de soutien de mes collègues, d’abord dans la ville, puis en Belgique. Leurs mots simples comme « tiens bon » ou « tu n’es pas seul » m’ont reconnecté à une communauté vivante.
Un appel de ma mentore, accompagné d’une vidéo d’arbres dans son jardin, m’a profondément touché. Le message était simple : « Merci, je suis avec toi. Tu as tout mon soutien. Ça va passer. » Ces gestes humains ont nourri ma dignité et affirmé que j’appartenais encore au réseau scientifique, malgré le chaos. Cela a montré que le partenariat dépasse la science : c’est un espace de soin mutuel et d’engagement sincère.
Cette expérience a profondément modifié ma conception de partenariat scientifique. Jadis, je la considérais comme un réseau organisé autour de projets, de financements et de publications. Désormais, je l'envisage comme une relation dynamique, apte à surmonter l'instabilité, voire l'anéantissement. La guerre a révélé que les actions les plus significatives sont parfois les plus élémentaires : une communication exempte d'exigences, une expression authentique, une disponibilité discrète. Ce sont des actes de soutien intellectuel, qui ne cherchent pas à résoudre, mais à reconnaître.
Ceci m'amène à soulever une interrogation troublante mais essentielle : et si la collaboration consistait d'abord à établir le lien ? Et si ce lien, dans le temps, avait parfois plus de valeur que la performance des résultats escomptés ? Les chercheurs du Nord éprouvent parfois un sentiment d'impuissance, persuadés que seules les actions tangibles ont de la valeur. Or, la présence constitue déjà une intervention. Être présent, à l'écoute, c'est refuser l'abandon. C'est préserver la valeur de la collaboration, même lorsque les projets sont interrompus. Mon expérience révèle que la crainte d'agir de manière inappropriée conduit parfois les partenaires du Nord à se taire, à s'éloigner. Pourtant, l'essentiel n'est pas d'agir parfaitement, mais d'être présent. Une communication imparfaite, une parole maladroite, sont préférables au silence. Collaborer, c'est oser maintenir le lien, même en l'absence de réponse ou de solution immédiate.
Ce que j’ai vécu n’est pas une anecdote personnelle. C’est une fenêtre ouverte sur une autre manière de faire la science ensemble. Une science du lien, ancrée dans l’humain. Ce type de partenariat ne nie pas les déséquilibres, mais cherche à les rendre visibles, à y répondre par une éthique de la constance. Il ne s’agit pas d’idéaliser la solidarité ni de culpabiliser les partenaires du Nord. Il s’agit de reconnaître que, dans certaines situations, ce qui tient une collaboration, c’est d’abord la fidélité du lien. Ce lien peut être fragile, incertain, maladroit. Mais il est réel, et il transforme.
En ce sens, les gestes de mes collègues n’étaient pas de simples actes affectifs. Ils étaient aussi des actes scientifiques, car ils ont permis que la pensée continue, que le projet ne meure pas entièrement, même si sa forme changeait. Ma situation pousse à penser une épistémologie relationnelle, où la qualité du lien est constitutive du travail scientifique. Ce n’est pas seulement la production de résultats qui fait la valeur d’un partenariat, mais la manière dont on tient dans l’épreuve, dont on choisit de rester reliés
Mon expérience personnelle devient ici une proposition collective : et si nous intégrions, dans nos pratiques scientifiques, une reconnaissance formelle de la vulnérabilité comme composante du terrain ? Et si nous reconnaissions que le soutien mutuel fait partie intégrante du travail de recherche, notamment en contexte de crise ? Cela suppose de repenser les indicateurs classiques du partenariat : au-delà des livrables, des résultats, des publications, comment évalue-t-on la qualité d’un lien ? Sa capacité à tenir, à écouter, à soutenir ? Cela suppose aussi de former les chercheurs du Nord à ces situations : non pour leur donner un “kit de survie morale”, mais pour les autoriser à rester présents, même sans solutions. Une science du lien ne remplace pas les exigences académiques. Elle les complète, en affirmant que la pensée, pour circuler, a besoin de reconnaissance, de solidarité, et de présence.